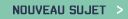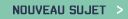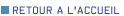Consulter les messages sans réponse | Consulter les sujets actifs
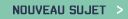 
|
Page 1 sur 1
|
[ 10 message(s) ] |
|
| Auteur |
Message |
|
Remi
|
 Sujet du message: Sujet du message: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Sam 13 Juil 2019, 21:17 |
|
Inscription : Dim 01 Sep 2002, 15:47
Message(s) : 1656
Localisation : sur mon siège
|
Bonjour Un autre anniversaire pour l'information télévisée cette année. Après les 70 ans du journal télévisé, les 50 ans de la réforme de 1969, première tentative de libéralisation de l'information. Je vous propose cette petite série illustrée... 1969 : l'information Nouvelle SociétéAprès le départ du général De Gaulle et l'élection de Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas est nommé Premier Ministre et développe une politique générale fondée sur le concept de nouvelle société, théorisé par Pierre Nora et Jacques Delors. La libéralisation de l'information en fait partie. Deux unités autonomes sont créées avec leurs propres équipes et leur propre budget. Pour la première chaîne, la nomination de Pierre Desgraupes fait grincer des dents car réputé trop indépendant. Sur la deuxième chaîne en couleurs, Jacqueline Baudrier se veut plus rassurante. Elle était de ceux qui ont fait la liste des licenciés de l'été 1968. Information PremièreAutour de Desgraupes : Joseph Pasteur, Olivier Todd, Christian Dutoit, François-Henri de Virieu, Philippe Gildas, Georges Walter, Danielle Breem, François de Closets, Emannuel de la Taille, Jean Lanzi, Bernard Volker, Jacques Abouchar, Maurice Werther, Michel Drucker, Jean-Michel Leulliot, Daniel Cazal, Georges Dominique, Jean-Pierre Lannes, Claude-Henri Salerne, Guy Claisse, Jean-Pierre Quittard, Francis Mercury, François Gault et Christian Bernadac forment la première équipe. Etienne Mougeotte et Paul Lefèvre arrivent ensuite rapidement d'Europe 1, puis Jean-Michel Desjeunes de RMC. Jean-Pierre Elkabbach revient ensuite de Bonn et l'équipe va être ensuite complétée avec Stéphane Paoli, Claude Carré, Jean-Claude Dassier, Jérôme Bellay Alexandre Baloud et Gérard Holtz, dernière recrue au printemps 1972. Les trois journaux Télé-Midi, Télé-Soir et Télé-Nuit conservent leurs indicatifs, mais la formule évolue. A 13 heures, Philippe Gildas réinvente un journal, avec des débuts hésitants. Claude-Henri Salerne, Jean-Pierre Lannes et Guy Claisse lancent le nouveau journal, épaulés par Jean Lanzi et Philippe Gildas lui-même. Paul Lefèvre viendra épauler l'équipe en 1971, qui se stabilisera ensuite autour de Jean Lanzi, Jean-Pierre Elkabbach et Jean-Michel Desjeunes. https://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/employees-of-the-first-channel-les-collaborateurs-du-news-photo/162760911?adppopup=truehttps://www.youtube.com/watch?v=wlHC_H0ptsIUn des premiers journaux de Télé-Midi dans son organisation toute provisoire... beaucoup de discussions et peu d'images ! A 19h45, Télé-Soir est d'abord confié aux patrons, Desgraupes et Pasteur. Rapidement, Jean Lanzi, Philippe Gildas, Etienne Mougeotte et Georges Walter forment le carré élémentaire de ce journal. [url]https://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/philippe-gildas-françois-gault-pierre-desgraupes-and-henri-news-photo/600217203?adppopup=true[/url] Le Télé-Nuit, d'abord confié à Etienne Mougeotte puis André Blanchet, sera l'occasion aux débutants de se roder à l'antenne, tels Stéphane Paoli ou Bernard Langlois. Outre les journaux, Information Première produit des magazines, comme A Armes égales, présenté par Alain Duhamel, Michel Bassi et André Capana, Panorama puis la nouvelle version de Cinq colonnes à la Une, baptisée Une première, préparée par Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet et Philippe Gildas. 24 heures sur la deux Sur la deuxième chaîne, l'équipe est plus ramassée. Autour de Jacqueline Baudrier, Jacques Alexandre, Jacques-Ollivier Chattard et Michel Péricard forment les cadres de la rédaction. A la présentation de 24 heures sur la deux, Léon Zitrone, Louis-Roland Neil, Jacques Ourévitch, venu lui aussi d'Europe 1, René Marchand et de jeunes journalistes tels Claude Brovelli, Alain Fernbach, Joseph Poli, André Sabas, Claude Guillaumin, Jean-François Robinet, Jean-Pierre Chapel et Jean-Pierre Berthet. La formule est assez différente avec une tranche d'information d'une heure, d'abord positionnée à 20 heures avec un magazine et un journal à 20h30. La formule sera ensuite avancée de 30 minutes et un débat hebdomadaire sera organisé le vendredi, précédant le journal. https://www.gettyimages.ca/detail/news-photo/jacqueline-baudrier-sat-on-a-golden-armchair-surrounded-news-photo/600217013?adppopup=trueL'équipe de la deuxième chaîne est composée de journalistes qui n'ont pas vraiment eu de problèmes à l'été 1968 mais va se distinguer, par la couleur, avec ses reportages de grand format et ses magazines d'actualité, comme Troisième Oeil ou L'Heure de Vérité (première émission à porter ce nom). Malheureusement, on en sait peu sur cette rédaction, les archives étant essentiellement composés de journaux de la première chaîne. Qui plus est, seuls 15 à 20% des postes étaient équipés pour capter la seconde chaîne, d'où les tensions avec une partie des élus gaullistes qui voyaient d'un mauvais oeil le fait de cantonner une équipe fidèle à une chaîne encore en devenir, alors que certains considéraient que l'indépendance de l'équipe Desgraupes était une menace pour la stabilité de la République. A suivre...
Dernière édition par Remi le Lun 29 Juil 2019, 15:14, édité 1 fois.
|
|
| Haut |
|
 |
|
Remi
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Ven 26 Juil 2019, 10:37 |
|
Inscription : Dim 01 Sep 2002, 15:47
Message(s) : 1656
Localisation : sur mon siège
|
Bonsoir Deuxième épisode 1970 : les réglagesUne question d'horairePour les premiers pas de la réforme, les deux journaux du soir ne se chevauchent pas. Télé-Soir commence à 19h45 et s'achève à 20h15 tandis que la partie JT de 24 heures sur la 2 ne débute qu'à 20h30 pour s'achever à 21 heures. Une formule qui ne va pas durer car le programme de la 2ème chaîne débute trop tard. Par conséquent, la grille du soir va être remaniée sur la 2 avec un JT à 20 heures, tant pis pour la non-concurrence frontale souhaitée initialement. L'évolution de Télé-MidiA Information Première, le Télé-Midi tâtonne encore, avec peu de moyens et des journalistes moins chevronnés : Alain Cancès, Guy Claisse, Jean-Pierre Lannes constituent les pivots de ce journal, avec l'appui de Bernard Volker. Pour féminiser un peu l'antenne, Jacqueline Alexandre et France Guéritée sont chargées d'animer la partie magazine de l'édition. https://www.youtube.com/watch?v=qatb8ZkJYswEdition présentée par Guy Claisse et Georges Dominique, Jacqueline Alexandre pour la partie magazine refermant le journal du 12 mars 1970 https://www.youtube.com/watch?v=Tu8CcjRB1J0Il arrive parfois que les téléphones sonnent souvent sur le plateau... et ce ne sont pas les iphone des journalistes ! https://www.youtube.com/watch?v=qfBMrizd7GsEdition du 7 mai avec Alain Cancès, Georges Dominique et France Guéritée https://www.youtube.com/watch?v=UVfAtmX3H-U11 octobre : rares sont les archives des journaux présentés par Etienne Mougeotte. Invisible à l'antenne, Michel Denisot, venu de la station régionale de Châteauroux, assure la coordination de la rédaction parisienne avec les différentes antennes pour alimenter l'édition de mi-journée. A la rentrée d'octobre, le journal évolue petit à petit avec notamment le transfert de Jean Lanzi à la mi-journée, le Télé-Soir, dont il n'existe pas d'archive complète, étant confié à Philippe Gildas, Etienne Mougeotte et Georges Walter. [url] https://www.youtube.com/watch?v=Kq2xOSZlwCY[/url] https://media.gettyimages.com/photos/franois-gault-jeanmichel-leulliot-etienne-mougeotte-danile-breem-and-picture-id600217679?s=612x61Plateau de Télé-Soir présenté par Etienne Mougeotte avec Danièle Breem, François Gault et Jean-Michel Leulliot [url] https://media.gettyimages.com/photos/da ... ?s=612x612[/url] Autre image, avec cette fois-ci Michel Drucker et François-Henri de Virieu avec Danièle Breem Le décès du général De GaulleDès son annonce, les deux rédactions fusionnent pour présenter des éditions communes durant 3 jours et pendant les cérémonies religieuses. Une situation facilitée par le voisinage des deux entités à Cognacq-Jay mais qui montre que la compétition voulue par le Premier Ministre reste cependant toute relative face aux événements. Ce ne sera pas la seule situation puisque la soirée électorale du référendum sur l'adhésion du Royaume-Uni à la CEE donnera aussi lieu à une émission commune aux deux rédactions. https://www.youtube.com/watch?v=-3d_Y22oN-IEdition spéciale du 11 novembre avec Georges Walter (Information Première), René Marchand et Jean-Pierre Chapel (24 heures sur la 2) https://www.youtube.com/watch?v=FJ5_MmvbBrAEdition du 15 décembre avec Georges Walter https://www.youtube.com/watch?v=IEbykQTKO6cEdition du 24 décembre, une des premières archives avec Jean-Michel Desjeunes arrivé de RMC, récupéré par Philippe Gildas qui l'avait embauché en 1965 à RTL
Dernière édition par Remi le Lun 29 Juil 2019, 15:25, édité 2 fois.
|
|
| Haut |
|
 |
|
Apollo 11 (ex-Poitevine)
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Sam 27 Juil 2019, 9:56 |
|
| Inscrit sur les forums |
 |
Inscription : Sam 28 Août 2004, 15:47
Message(s) : 1090
Localisation : Vendée depuis 2008
|
|
Prémisces de l'éclatement de l'ORTF ?...
_________________
Tous passages télé de Patrick Roy hors de ses émissions
Tous passages télé de l'astronaute Thomas Pesquet < 2016
Archives Radio Monte Carlo < 2001
SVP merci !!!
|
|
| Haut |
|
 |
|
valflut
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Sam 27 Juil 2019, 10:34 |
|
Inscription : Dim 20 Jan 2008, 12:57
Message(s) : 203
|
|
Merci pour ces articles riches et très documentés ! Étonnant, cette période... Il y avait tellement peu de journalistes à l'époque que les grandes vagues de licenciement de 1968 ont abouti à une vaste redistribution des cartes... Tant mieux pour l'innovation à la télé, spécialement autour de Pierre Desgraupes !
Hâte d'en apprendre plus, vivement les prochains épisodes !
|
|
| Haut |
|
 |
|
Remi
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Dim 28 Juil 2019, 12:21 |
|
Inscription : Dim 01 Sep 2002, 15:47
Message(s) : 1656
Localisation : sur mon siège
|
|
Bonjour
Oui, c'est une période peu connue dans l'histoire mais qui a été assez déterminante. C'est la première fois qu'on a pu ouvrir les vannes - un peu - et desserrer la pression du pouvoir.
Suite au prochain épisode !
Rémi
|
|
| Haut |
|
 |
|
Glouglouste
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Dim 28 Juil 2019, 14:50 |
|
Inscription : Sam 17 Nov 2007, 18:45
Message(s) : 9963
|
|
Merci Rémi. Intéressant, bien illustré et contextualisé. Vivement la suite en effet !
|
|
| Haut |
|
 |
|
Remi
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Jeu 01 Août 2019, 19:13 |
|
Inscription : Dim 01 Sep 2002, 15:47
Message(s) : 1656
Localisation : sur mon siège
|
Bonsoir
1971 : le JT à l'américaineDurant cette année, les deux unités autonomes d'information poursuivent chacune leur trajectoire. Sur la deuxième chaîne, 24 heures sur la 2 propose désormais son magazine à 19h30 et son journal à 20 heures. En complément, un reportage grand format est diffusé en soirée avant 24 heures dernière : L'événement des 24 heures propose un format inédit d'une quinzaine de minutes sur le fait du jour, ce qui constitue une forme de prouesse pour délivrer chaque soir un reportage poussé, sachant les moyens techniques encore rudimentaires. A Information Première, les journaux évoluent surtout par l'usage plus systématique de l'eidophor pour illustrer les lancements des présentateurs : jusqu'à présent, il était assez peu utilisé. Télé-Midi est confié à Jean Lanzi, Jean-Michel Desjeunes et Paul Lefèvre, tandis que Télé-Soir reste dans l'alternance entre Philippe Gildas, Etienne Mougeotte et Georges Walter. Pierre Desgraupes demande cette année-là à Philippe Gildas, rédacteur en chef, d'aller aux Etats-Unis pour étudier les journaux télévisés des grandes chaînes américaines. Se rendant chez ABC et CBS, il y découvre des journaux vecteurs d'importantes pages de publicité, le mélange des genres entre l'information, le divertissement et la réclame, mais aussi que les présentateurs ont tous de la bouteille : à Information Première, tous les présentateurs ont moins de 40 ans, certains débutants ont entre 25 et 30 ans, ce qui apparaît impossible aux américains qui considèrent qu'à moins de 55 ans, on ne peut être crédible. Autre élément décisif : le présentateur unique, chaque soir. En France, sur les deux chaînes, les journalistes varient : trois journalistes pour chaque édition à Information Première, et quasiment un visage par jour à 24 heures sur la 2 (même si tout le monde ne retient que Léon Zitrone, mais rendons leur part à Claude Brovelli, Jean-François Robinet, René Marchand, Jacques Ourévitch, André Sabas et Jean-Pierre Berthet). De retour, Philippe Gildas suggère d'essayer la formule d'un présentateur unique et, pour avoir un journaliste d'âge mûr, propose à Desgraupes d'aller à Télé-Soir... ce qu'il refuse. Ce sera finalement Joseph Pasteur, son adjoint, qui n'a guère plus de 40 ans mais qui fait plus que son âge. Pasteur demande qu'on ressorte des placards un télé-prompteur, car apprendre par coeur les textes 5 jours de suite, après les avoir écrit, ce qui supposait de faire de multiples allers-retours dans le dédale de Cognacq-Jay, était tout simplement impossible. Outre cet appareil, Information Première recrute un journaliste chargé de préparer les textes des lancements, directement au visionnage. Venu de RTL, Alexandre Baloud seconda ainsi Joseph Pasteur et la formule débuta à la rentrée 1971. Le week-end, Etienne Mougeotte et Philippe Gildas se relaient à 19h45. Jean-Pierre Elkabbach revient de Bonn, où il était correspondant permanent : Michel Meyer le remplace lors de son intégration dans l'équipe du journal de 13 heures. La stabilisation du Télé-Midi et surtout l'effet Desjeunes, qui était alors très populaire à la radio, va encore innover avec l'apparition des premiers directs à l'extérieur, pour différentes occasions, du salon informatique à la rentrée des classes en passant par les grands voyages présidentiels dans les régions, les départs en vacances ou le Tour de France. Ces journaux constituent pour l'époque des prouesses techniques. https://www.youtube.com/watch?v=qfcJt0iDni8Télé-Midi spécial du 17 mai 1971 avec Lanzi depuis Bordeaux et Thierry Le Luron singeant le maire de la ville et Premier Ministre... https://www.youtube.com/watch?v=OnYbFiFqwVQTélé-Midi spécial du 25 mai 1971 avec Desjeunes à Paris et Lanzi à Anvers. Journal de 52 minutes ! Le développement des magazines se poursuit. Etienne Mougeotte crée l'hebdomadaire L'Actualité en question. https://www.gettyimages.fr/detail/photo-d'actualit%C3%A9/face-%C3%A0-etienne-mougeotte-et-jean-ferniot-notamment-photo-dactualit%C3%A9/982435834Etienne Mougeotte sur le plateau de l'émission L'actualité en question. Le magazine mensuel A armes égales, de Michel Bassi, André Campana, Jean-Pierre Alessandri et Alain Duhamel, va connaître une renommée par l'un des plus grands coups d'éclat en direct à la télévision française. Le concept de l'émission était d'inviter deux personnalités à réaliser un film sur le thème de l'émission. Ce 13 décembre 1971, l'émission portait sur l'évolution des moeurs et la culpabilité française. Invités : le maire de Tours, Jean Royer, et l'écrivain Maurice Clavel. https://www.youtube.com/watch?v=DnpN0nAOuL0Il faut préciser que le mot coupé au montage était "aversion" : Maurice Clavel rappelait une interview du président Pompidou et aurait interprété le mot "aversion" associé à la résistance pendant la deuxième guerre mondiale. Sujet ô combien sensible, à l'origine de ce coup de ciseau... mais quelles auraient été les réactions, quelle aurait été l'ampleur du scandale si ce terme avait été diffusé ? Nul ne le saura. Sur la deuxième chaîne, Michel Péricard crée le premier magazine baptisé L'heure de vérité (le titre sera repris en 1982), dont le générique et la formule témoignent d'une approche plus moderne. https://www.ina.fr/video/CAF88011343/pierre-dreyfus-pdg-de-la-regie-renault-video.htmlChacune à leur façon, les deux unités d'information transforment l'information télévisée. A posteriori, Information Première, dans un cadre qui finalement a peu évolué, a d'abord misé sur le ton de ses journalistes, largement importé des postes périphériques, et sur la stature de Pierre Desgraupes pour conquérir un peu plus de liberté dans le traitement des sujets et notamment de la politique intérieure. A 24 heures sur la deux, la couleur est une force - mais aussi un handicap car peu de postes encore peuvent la capter - et Jacqueline Baudrier, mieux perçue par la majorité, développe une écriture des journaux fondée sur des séquences longues en image et un montage plus nerveux, plus moderne, ce qui contraste évidemment avec la figure de proue, Léon Zitrone, prié d'évoluer dans sa façon de présenter le journal. Bref, à la fin de l'année 1971, les deux rédactions poursuivent d'améliorer leurs productions. Mais les nuages approchent... A suivre
|
|
| Haut |
|
 |
|
Remi
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Mer 07 Août 2019, 13:58 |
|
Inscription : Dim 01 Sep 2002, 15:47
Message(s) : 1656
Localisation : sur mon siège
|
Bonjour 1972 : contre-réforme et troisième chaîneCe sera la dernière année de la réforme de 1969 : une conjoncture de facteurs, pour la plupart politiques, vont amener à remettre en cause les unités autonomes d'information créées deux ans et demi plus tôt. Pourtant, l'année débutait avec une série de nouveautés dont l'une sera pour le moins avant-gardiste Télé Midi 72 ou l'ancêtre de Nulle Part Ailleurs ?Du changement à la mi-journée sur la première chaîne avec un concept totalement nouveau mélangeant l'information et le divertissement. Midi Magazine, l'émission de Danielle Gilbert, et le journal de 13 heures fusionnent dans une seule et même émission. Jean-Michel Desjeunes lâche la présentation du Télé-Midi, confié en alternance à Jean Lanzi et Jean-Pierre Elkabbach. Dès 12h30, Télé Midi 72 accueille des vedettes du spectacle, des écrivains pour un quart d'heure d'actualité culturelle et de divertissement. L'information arrive à 12h45 pour environ 15 à 18 minutes selon les jours, avant de revenir dans l'autre partie du plateau, aménagée en salon avec canapés. A 13h20, une nouvelle formule d' Hebdo-Midi, la page magazine, complète le programme qui se termine vers 13h45 par un rappel des titres de l'actualité. La formule dura cependant 2 mois seulement, du lundi 3 janvier au vendredi 4 mars 1972, avant de revenir à une séparation plus stricte entre information et variétés. https://www.youtube.com/watch?v=YBlTm7NoeI4Il est tout de même difficile de ne pas rappeler que Philippe Gildas était à l'époque rédacteur en chef à Information Première et qu'il avait déjà, à la radio sur RTL, développé la session du matin mélangeant informations et divertissements entre 6h et 9h. Les origines de Nulle Part Ailleurs se retrouvent probablement dans cette émission éphémère. Une feuille d'impôt et des reportages sur l'Algérie qui font valser un Premier MinistreRévélé par Le Canard Enchaîné, l'affaire des impôts de Jacques Chaban-Delmas vient raviver les tensions au sein de la majorité politique : le Premier Ministre n'aurait pas payé d'impôts de 1967 à 1970 lorsqu'il était Président de l'Assemblée Nationale, par le truchement d'une faille dans la réglementation fiscale. Pour Matignon, le ministre des Finances, qui cache de moins en moins ses ambitions, est à la manoeuvre. Mais une partie de l'UDR critique de plus en plus clairement le Premier Ministre et surtout ne lui pardonne pas la réforme de l'information télévisée de 1969, considérée trop libre - authentique ! - et trop critique à l'égard de l'action du gouvernement. La rédaction d' Information Première va, bien malgré elle, en rajouter une couche : à l'occasion des 10 ans de l'indépendance de l'Algérie, trois émissions spéciales sont organisées en avril 1972. Le budget est disponible et le directeur n'a pas de compte à rendre puisque ces reportages sont financés par les économies réalisées au cours des deux années précédentes. Abordant un sujet encore extrêmement sensible dans l'opinion française, ces émissions diffusées à 20h30 vont provoquer un tollé dans la frange la plus radicale de l'UDR et parmi les nostalgiques de l'Algérie française. Si on y ajoute une affaire de publicité clandestine à la télévision et de quelques vedettes faisant quelques "ménages", commence à mijoter un cocktail explosif qui aura pour conséquence le renvoi de Jacques Chaban-Delmas, remplacé par un autre gaulliste, Pierre Messmer. Instantanément, Pierre Desgraupes démissionne de son poste de directeur d'Information Première, avec dans son sillage l'ensemble de la direction de l'unité d'information et des principaux journalistes. 24 heures sur la deux devient 24 heures sur la unePremière décision du gouvernement Messmer : le rétablissement du ministère de l'Information pour recadrer la radio et surtout la télévision. Philippe Malaud convoque Jacqueline Baudrier, directrice de 24 heures sur la 2 et lui propose de prendre la direction de l'information sur la première chaîne, ce qu'elle refuse d'abord, arguant que les journalistes avaient été choisi par Desgraupes et qu'il n'y aurait pas la légitimité nécessaire. Réponse sans équivoque du ministre : " vous n'avez pas compris : vous allez avec votre équipe sur la une". L'été donne lieu à l'apparition de quelques nouvelles têtes à la présentation du journal, notamment Alexandre Baloud et Jacques Idier. https://www.youtube.com/watch?v=__WoXtBDAd0Edition du 4 septembre 1972 avec Alexandre Baloud https://www.youtube.com/watch?v=eE0mIFNAphIEdition du 5 septembre 1972 avec Jacques Idier C'est ainsi que le 10 septembre 1972, Jean-Michel Desjeunes présente le dernier Télé-Midi (pas de trace de Télé-Soir) en faisant une étrange promotion pour le nouveau journal de la deuxième chaîne, INF2... https://www.youtube.com/watch?v=AneKKklkARQDernier Télé-Midi Le 11 septembre à 13 heures nait 24 heures sur la une, présenté par Jean-François Robinet, accompagné pour la première du directeur adjoint, Jacques Alexandre. Le soir, à 19h45, Jacqueline Baudrier et Jacques Alexandre concluent le journal présenté par Léon Zitrone. https://www.youtube.com/watch?v=pAgqBFZTDh0Première édition de 24 heures sur la une à 13 heures. https://www.ina.fr/video/CAF97072867/jacqueline-baudrier-et-jacques-alexandre-parlent-du-nouveau-journal-televise-video.htmlDéclaration de Jacqueline Baudrier et Jacques Alexandre à l'issue de la deuxième édition de 24 heures sur la une à 19h45. C'est un fait unique dans l'histoire de la télévision, signe d'une époque où le contrôle par le gouvernement était encore fort et le public encore relativement crédule : on a inversé les deux rédactions télévisées pour des raisons de conformité à la ligne politique du gouvernement... et ça se sent dans les déclarations à l'antenne ! 24 heures sur la une est essentiellement constituée des journalistes présents au côté de Jacqueline Baudrier depuis 1969. Bernard Volker sera un des rares transfuges, ainsi que l'équipe de journalistes de l'émission A Armes égales, qui resteront une année de plus à l'antenne. L'équipe perd la couleur mais gagne largement en audience. A la présentation du journal, une alternance de visages chaque jour : Léon Zitrone évidemment, mais aussi Claude Brovelli, Claude Guillaumin, Bernard Volker, Jean-Pierre Berthet, Jean-François Robinet et André Sabas. S'y ajoutent notamment Patrice Duhamel, Alain Fernbach, Joseph Poli, Michel Péricard, Louis Bériot et Thierry de Scitivaux. L'équipe doit produire 3 éditions et les magazines hebdomadaires et mensuels de reportage. La nouvelle rédaction de la seconde chaîneUne partie des journalistes d' Information Première quitte l'ORTF. Philippe Gildas et Etienne Mougeotte sont recrutés par RTL pour les informations du matin avec slogan " vous les avez vus à la télé, ils sont sur RTL". Ce sera la première d'une longue série qui se poursuit encore aujourd'hui. D'autres rejoindront la presse écrite, comme Hervé Chabalier rejoignant Le Nouvel Observateur. Cependant, la plupart des journalistes se retrouve dans la nouvelle rédaction de la seconde chaîne : INF2 est dirigée par Jean-Claude Héberlé. On y retrouve au journal de 20 heures des piliers d' Information Première, à commencer par Jean-Michel Desjeunes, Jean-Pierre Elkabbach, Paul Lefèvre, mais aussi de nouvelles recrues : Daniel Bilalian, Gérard Holtz, Jean-Marie Cavada et Pierre Lescure, qui retrouve donc Desjeunes connu à la radio sur RTL (grâce à Philippe Gildas). Le journal de 20 heures est confié en alternance à Lescure, Desjeunes, Elkabbach et Cavada. Danielle Breem tient le service politique, accompagné par Jacques Idier. Le service Etranger, emmené par Jean-Pierre Elkabbach, est constitué de journalistes qu'on retrouvera encore pendant 20 ans sur Antenne 2, comme Pierre Serra, Gérard Sebag, Jacques Abouchar, mais aussi Gérard Holtz (eh oui !). France Roche tient le service culture et Pierre Lescure dirige celui baptisé Vie Moderne. https://media.gettyimages.com/photos/journalists-and-tv-newscasters-philippe-harrouard-pierre-lavigne-picture-id600214023?s=612x612Debout : Philippe Harrouard, Pierre Lavigne, Gérard Holtz - Assis : Pierre Lescure, Paul Lefèvre et Jean-Michel Desjeunes Avec la couleur, des journalistes assez jeunes, une mise en page du journal dynamique, une place importante consacrée à l'actualité internationale, INF2 profite aussi de l'augmentation des ventes de téléviseurs couleurs et son audience rejoint celle de la première chaîne. Jean-Pierre Elkabbach crée Actuel 2, une émission hebdomadaire consacré à un sujet, un invité, abordé par différents reportages et sous le regard de 3 journalistes de presse écrite ou de la radio-télévision. Apparaît également le dimanche un journal à la mi-journée : INF2 dimanche propose 15 minutes d'actualité et une série de reportages. En revanche, on ne sait toujours ce que veut dire l'abréviation INF, et la symbolique des petits coquillages du générique reste mystérieuse... D'ailleurs, le premier indicatif d'I NF2 avait un côté pour le moins angoissant, dans un style à la Pierre Henry... https://www.youtube.com/watch?v=fFSiioGFeSEINF2 du 26 septembre 1972 présenté par Jean-Marie Cavada : à noter, la pendule-éphéméride en bas de l'écran et l'incrustation du nom du présentateur quelque peu bricolée... Rodage encore à l'antenne car Cavada évoque Télé-Nuit avec Alexandre Baloud, appellation disparue depuis 15 jours... https://m.ina.fr/video/I09182064/generi ... video.htmlGénérique du premier Actuel 2 Et voici la troisième chaîneCadeau pour la fin d'année 1972, la troisième chaîne ouvre son antenne le 31 décembre 1972 et parachève la réforme de la télévision. Emettant en fin de journée, elle est axée sur le cinéma, le théâtre et les régions. Elle est aussi un laboratoire de nouveautés. Confiée à Jean-Louis Guillaud, fidèle à la ligne politique gaullo-pompidollienne et écartée pendant 3 ans de l'antenne, la chaîne en couleurs se dote d'un véritable habillage d'antenne, conçu par une dessinatrice : Catherine Chaillet. C3 mise également sur la valorisation des productions des différentes stations régionales de l'ORTF, tant sur les programmes, les feuilletons, que sur l'information. La rédaction est dirigée par Christian Bernadac : Inter 3 est composée de journalistes de France Inter, les bureaux sont d'ailleurs situés non pas à Cognacq-Jay mais à la maison ronde. Cette unité d'information permet de former des journalistes de radio à la télévision. Secondé par Claude Pierrard, les journaux sont diffusés à 18h30 et 21h30. A la présentation : Dominique Bromberger, Jean-Claude Bourret, Patrick Poivre d'Arvor, Michel Denisot et Patrick de Carolis. https://www.youtube.com/watch?v=PAQeBl_z7lMPrésentation de la chaîne C3 par Jean Amadou et Maurice Horgues. D'une réforme à l'autreEn un peu moins de 3 ans, la réforme de l'été 1969 a donc quand même desserré l'étau sur l'information télévisée et insufflé un nouveau ton : la création de 2 rédactions a créé une émulation pour différencier les programmes, y compris dans un exercice académique comme le journal télévisé où l'arrivée, à Information Première, de journalistes venant des postes périphériques, RTL et Europe 1 pour l'essentiel, a modernisé le style et le ton. L'esprit indépendant de Pierre Desgraupes lui aura finalement coûté sa place mais en renforçant son image dans le grand public, car l'inversion des rédactions à la rentrée de 1972 n'est pas passée inaperçue. En dépit de la faiblesse des archives disponibles, il faut quand même mettre au crédit de 24 heures sur la 2 la volonté de tirer profit de la modernité incarnée par la couleur et d'accorder une place très importante à l'image et au reportage. On retiendra aussi la mise à l'antenne d'émissions comme La France défigurée, créée en 1971, assez avant-gardiste dans la prise en compte des aspects environnementaux. Toute politique soit-elle, la réforme de l'été 1972 a surtout eu pour conséquence d'équilibrer l'audience des deux chaînes, en profitant de l'équipement grandissant de la population en postes couleurs captant les deux chaînes, ce qui, en 1969, était encore très minoritaire (moins de 20% des récepteurs). Enfin, cette période a vu émerger - ou a confirmé - de nouvelles figures de la télévision. Pierre Desgraupes a ainsi révélé Etienne Mougeotte, Philippe Gildas, Jerome Bellay, Jean-Pierre Guérin, Hervé Chabalier, Jean-Pierre Elkabbach, Jean Lanzi, qui tous auront par la suite un rôle important dans la télévision d'aujourd'hui. C'est moins le cas de l'équipe Baudrier de laquelle émergea surtout Patrice Duhamel, Jean-Pierre Berthet et Joseph Poli mais dans des rôles de second plan, sauf pour le premier. A suivre...
|
|
| Haut |
|
 |
|
Remi
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Mar 28 Mars 2023, 15:11 |
|
Inscription : Dim 01 Sep 2002, 15:47
Message(s) : 1656
Localisation : sur mon siège
|
|
Bonjour
Petites précisions en consultant les archives du Monde :
Il s'en est fallu de peu pour que disparaisse le journal sur la 2 suite à la décision d'inverser les rédactions : dans ce contexte surréaliste, ça ne se bousculait pas pour restaurer une équipe. Aucun des cadres autour de Desgraupes n'a voulu y aller, d'où la désignation de Jean Lefèvre, flanqué de Jean-Claude Héberlé et Jean-Pierre Elkabbach comme rédacteurs en chef. INF2 n'avait que 50 collaborateurs !
L'audience de la 2 a profité d'un certain malaise des téléspectateurs de la 1, notamment du fait du retour de Zitrone et de la reprise en mains. Cela correspondait aussi à l'accélération des achats de postes couleur. Si bien que les deux chaînes ont réduit leur écart du fait de la modernité relative supérieure de la 2. D'où la décision de casser INF2 en 1973 avec la suppression du 20h en une édition de 19h15 et une édition à 22h. Il y a eu tellement de courriers que ça n'a pas tenu longtemps et INF2 a véritablement égalé l'audience de 24h sur la Une.
Rémi
|
|
| Haut |
|
 |
|
FredC.
|
 Sujet du message: Sujet du message: Re: 1969-2019 : les 50 ans d'une réforme décisive Publié: Mar 28 Mars 2023, 15:56 |
|
Inscription : Ven 27 Juil 2018, 14:23
Message(s) : 6311
Localisation : Entre Paris et Bruxelles.
|
|
Merci pour toutes ces infos, Rémi !
_________________
"La politique étrangère commence à la Maison" (Darius Rochebin)
|
|
| Haut |
|
 |
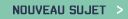 
|
Page 1 sur 1
|
[ 10 message(s) ] |
|
Qui est en ligne ? |
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invité(s) |
|
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
|
|